

Accueil > Sommaire des dossiers > Le mur du son
En accordant, en particulier au début de l’apprentissage, une importance certaine à la maîtrise des traits prosodiques et segmentaux de la langue étrangère, nous permettons aux participants d’établir une autre forme de contact avec la langue étrangère et de développer en même temps des attitudes et aptitudes importantes dans l’apprentissage d’une langue.
"Avec l'œil nous allons vers la langue,
Par l'oreille la langue entre en nous."
En sensibilisant dès le début de l’apprentissage les participants aux particularités de la prononciation de la langue étrangère à l’aide d’exercices conçus à cet effet, le rapport avec la langue est fortement facilité. La langue perd (une partie de) son caractère étranger et peut ainsi être plus facilement intégrée.
Comme elle est vécue de l’intérieur, les barrières linguistiques peuvent être réduites, de sorte qu’une proximité et une familiarité avec la langue étrangère peut s’établir. Ceci favorise une ouverture pour ce qui est nouveau, étrange et étranger.
De plus prononcer une langue étrangère de manière correcte permet d’en apprécier la beauté, la poésie (10), de la vivre dans sa dimension esthétique, ce qui peut renforcer une relation positive à cette langue. Certains exercices de prononciation éveillent chez les participants un plaisir oral dans cette langue (11) et leur permettent de savourer l’étrangeté de ses sonorités.
"Le don des langues n'est autre chose que le don de l'écoute."
(Alfred Tomatis, Nous sommes tous nés polyglottes)
Un grand nombre d’exercices de prononciation conduisent au développement d’une précision dans la perception, à une exactitude dans l’observation et à une augmentation de l’attention et de la réceptivité, des qualités et des aptitudes qui peuvent être transposées dans l’apprentissage de la syntaxe et du lexique de la langue étrangère ou même dans la perception de différences culturelles. Ils sensibilisent à l’importance de détails, une attitude qui est profitable à l’apprentissage et à l’acquisition d’une langue en général.
Quand on pense à l’apprentissage de la prononciation, on pense au fait que le locuteur sera mieux compris, mais cet apprentissage a aussi une importance sur la capacité de compréhension du locuteur lui-même.
Il s’agit d’un aspect tellement évident que nous n’avons pas besoin de l’approfondir. Lorsque la prononciation est bonne, les auditeurs doivent moins faire d’efforts pour comprendre le locuteur, leur écoute et leur attention sont facilitées. La communication d’une manière générale est donc rendue plus aisée.
Une perception précise des caractéristiques phoniques de la langue étrangère constitue une base importante pour mieux comprendre les locuteurs de la langue cible, car comprendre présuppose qu’on perçoive et qu’on entende correctement ce que l’interlocuteur dit.
En raison de sa fonction démarcative l’intonation structure la communication orale et facilite l’appréhension de la construction de la phrase. Par sa fonction contrastive, elle met en relief ce qui est important dans le message.
Pour saisir l’importance d’un énoncé, il est non seulement important de saisir, ce qui est dit, mais aussi et surtout ce qui est exprimé, l’intonation traduit l’intention du locuteur qui exprime même parfois à travers elle des choses qu’il ne veut pas dire explicitement. Elle joue un rôle essentiel dans le processus de compréhension, car elle contribue à la perception de la signification du message et non seulement à l'appréhension du sens de l’énoncé (12).
"Non seulement comprendre ce que dit l'autre, mais comprendre l'autre."
Le décodage de la communication verbale ne se situe pas seulement à un niveau intellectuel dans un processus de décodage strictement cognitif qui resterait sur un plan uniquement linguistique, mais en même temps à un niveau affectif et relationnel. On ne s’adresse pas seulement à l’intelligence conceptuelle des participants mais aussi à leur intuition dans le processus de compréhension. L’attention ne se porte donc pas uniquement vers les mots mais englobe aussi les tonalités de l’énoncé. La perception des informations portées par l’intonation permet d’accéder au sens profond de l'énoncé et à ses composantes implicites. Cette sensibilisation contribue à développer un niveau de communication plus profond entre les participants ainsi qu'une écoute empathique entre eux.
"Le sens hante le son."
(Paul Valéry)
À l’aide d’exercices ciblés les participants sont sensibilisés à une écoute plus précise et apprennent à percevoir ce qui est sous-jacent dans les énoncés et donc à ne pas rester à la surface des mots. La perception du "COMMENT", c’est-à dire la manière de communiquer le message peut aussi permettre une meilleure compréhension du "QUOI", c’est-à-dire du contenu linguistique du message. À travers la signification de l’énoncé les participants peuvent parfois mieux saisir le sens des mots (13), nous passons alors de la perception subjective de la signification, de la portée connotative du message au sens dénotatif des parties inconnues de l’énoncé.
Des malentendus peuvent être évités grâce à la maîtrise de l’intonation de la langue étrangère. Ainsi la courbe d’implication en français (voir Delattre, 1966) est souvent mal décodée par les Allemands. Cette courbe est utilisée quand le locuteur pense que ce qu’il dit ne permet aucun doute ou que cela va de soi. Lorsque à la question "Qui l’a fait ?" l’interlocuteur répond en utilisant la courbe d’implication : "Mon voisin !" et que celui qui a posé la question demande : "Tu es sûr ?", il peut recevoir une réponse impatiente du type : "Puisque je te le dis !"
L’importance de la prononciation est aussi valable dans le domaine segmental, ainsi que la phonologie l’a démontré. La maîtrise des différences pertinentes entre les sons d’une langue facilite fortement la compréhension des énoncés. Un étranger qui ne perçoit pas la différence entre [z] et [s] a des difficultés supplémentaires pour comprendre des énoncés dans lesquels se trouvent par exemple un élément d’une opposition classique du type : Ils ont/Ils sont, Vous avez/Vous savez, Ils entendent bien/Ils s’entendent bien, Six heures/Six sœurs, Ils aiment /Ils sèment, Les ruses/Les Russes… Ce sont pour lui des homophones, il lui faut donc faire beaucoup plus d’efforts pour décoder le texte, ce n’est parfois qu’en faisant appel au contexte qu’il peut savoir de quel mot il s’agit et ce contexte lui-même peut parfois comporter des ambigüités : Ils sont six/Ils ont six, Vous avez tout/Vous savez tout…
Il arrive d’ailleurs qu’un entraînement insuffisant ou maladroit de la prononciation ne conduise qu’à une meilleure capacité de perception, le participant n’est pas mieux compris, mais comprend mieux. Si l’on s’imagine que perception et prononciation représentent les deux côtés d’une même médaille, seul un côté de la médaille est maîtrisé (14).
L’intonation permet aussi d’élargir les possibilités d’expression des participants, car ils peuvent s’exprimer de manière plus précise et avec plus de nuances. Elle peut même permettre de pallier certaines lacunes lexicales. Si un participant ne sait pas dire en français le mot "il est désagréable", il peut dire "il est gentil !", "il est agréable !" sur un ton qui exprime le contraire.
L’intonation a donc une fonction complémentaire au "texte" de l’énoncé, elle peut le soutenir, le nuancer ou le transformer en son contraire. La maîtrise de l’intonation permet donc plus de flexibilité et plus de liberté dans l’expression.
"Something too new is also too strange for us to hold in memory."
(Charles Curran, Counseling-Learning in Second Languages)
Comme la langue devient plus familière (voir ci-dessus), elle peut aussi être mieux retenue et mieux intégrée, car les barrières face à la langue étrangère peuvent être réduites ou supprimées.
Quand les contenus linguistiques ne sont pas transmis de manière neutre (les textes des manuels en raison de leur fonctionnalité pédagogique ont souvent cette tendance) mais rendus vivants par le fait que les locuteurs s’expriment et donc utilisent une intonation qui porte leurs propos, ils sont mieux intégrés.
Certains exercices de prononciation contribuent au développement de la mémoire auditive qui est une composante indispensable à l’acquisition d’une langue étrangère (16). Nous faisons souvent appel à des poèmes qui contiennent de manière concentrée les caractéristiques rythmiques et mélodiques de la langue cible. Le travail avec des poèmes favorise également la rétention des éléments linguistiques qui les composent en raison de leur rythme, de leur rime, de leur force d’évocation, de leurs métaphores, de la profondeur ou de la justesse de leur contenu, ou parfois de leur manière concise de dire les choses.
L’association de la langue et de mouvements est essentiel dans ce travail, or les mouvements favorisent également la rétention d’éléments linguistiques nouveaux. Ils ont une fonction d’ancrage (mémoire kinésique), car ils associent à la fois le visuel et le gestuel. Ces mouvements sont transmis progressivement jusqu’à ce qu’ils soient en place sans laisser aux participants l’impression d’une répétition fastidieuse. Les participants conservent en mémoire des parties de textes ou parfois des textes entiers sans les avoir appris par cœur (17).
"Structures acoustiques et morpho-syntaxiques sont intimement liées."
(Jean Cureau et Branko Vuletic)
Nous ne pouvons séparer les structures syntaxiques des courbes intonatives qui les composent. Il y a une interpénétration entre ces deux composantes du langage (18).
La différence entre la question, l’énonciation simple et un ordre qui disposent de la même structure syntaxique, est marquée par une différence de la courbe mélodique à l’oral : Vous venez ? Vous venez. Vous venez ! Les courbes mélodiques permettent également de structurer la différence entre thème et rhème et donc de mieux saisir la structure de la phrase.
Certains exercices de prononciation peuvent contribuer à la maîtrise des structures grammaticales (19). Les particularités structurelles peuvent souvent être mieux illustrées à l’aide d’un poème qu’à travers une règle à l’énoncé un peu sec (20). La force poétique de ces textes permet aux participants de mieux intégrer certains phénomènes grammaticaux qu’ils soient d'ordre morphologique ou syntaxique.
En raison du travail de précision que suscite l’apprentissage de la prononciation, les participants apprennent à travailler de manière précise et à développer leurs capacités d’observation. Cette précision dans l’observation peut se transposer dans le domaine de l’écrit, que ce soit dans le domaine de l’accord, de la morphologie ou de l’orthographe.
Une prononciation correcte peut permettre d’éviter des fautes d’orthographe. Voici quelques exemples de fautes d’accents commises par les germanophones : prémier*, déhors*, réligion*, réflète*, rélation*, rétour*, ésprit*, prémier*, repète*… ces fautes pourraient être évitées si les participants disposaient d’une meilleure prononciation. Trocmé-Fabre cite une expérience de Luria qui met en relief les rapports entre l’écrit et l’oral : "Rappelons l’expérience faite par Luria : des enfants à qui l'on avait permis de prononcer les mots de leur dictée ont fait six fois moins de fautes d’orthographe que le groupe d'enfants qui avaient dû écrire la dictée sans remuer les lèvres." Trocmé-Fabre, H. (1987, 141) (21).
Pour retrouver l’écriture du participe passé en français, beaucoup de français font appel à la prononciation, donc à leur mémoire auditive : "je l'ai pris" au féminin, on dit "prise", donc "pris" s’écrit avec un <s>.
Quelques poèmes peuvent contribuer à la maîtrise de difficultés orthographiques, c’est le cas de Les Hiboux de Robert Desnos, qui thématise l’orthographe du pluriel des mots en "ou". Les poèmes auxquels nous faisons appel en relation avec l’entraînement à la prononciation établissent des passerelles entre la langue écrite et la langue orale (22). Ils créent non seulement un accès aux textes poétiques, mais ils invitent à utiliser également la liberté qu’offre la langue poétique. Cette attitude positive par rapport à la langue étrangère peut aussi faciliter l’accès à sa transposition écrite qui paraît parfois un peu sèche et stimuler une attitude créatrice dans le domaine de l’écrit.
Il nous arrive lors de création de textes écrits en sous-groupes (par exemple en composant un texte sur une structure rythmique donnée ou en reprenant la structure d'un poème…) de demander à chaque sous-groupe d'en préparer ensuite une présentation orale qui fasse ressortir le sens de leur texte en faisant appel à des jeux de voix (modulation de la voix, écho, reprise par un chœur…). Ce passage de l'écrit à l'oral permet non seulement aux participants de donner vie à leur texte écrit et souvent de le valoriser, mais également d'apprendre à élargir la palette de leur expression vocale et à ressentir la relation entre son et sens.
Une bonne prononciation contribue au développement d’une certaine assurance dans la langue étrangère, car les participants maîtrisent quelque chose de fondamental et d’essentiel dans cette langue, ils se sentent donc plus chez eux dans la langue étrangère. Ce sentiment peut non seulement augmenter leur confiance en eux-mêmes mais aussi stimuler leur motivation.
Posséder une bonne prononciation donne souvent l’impression de disposer d’une bonne maîtrise de la langue étrangère. Une prononciation correcte et fluide peut compenser ou même masquer d’autres erreurs : une erreur syntaxique semble souvent plus légère quand elle est intégrée dans une bonne prononciation. À l’inverse il est très décevant pour des participants de pouvoir s’exprimer correctement sur le plan grammatical et lexical et malgré cela de se sentir difficilement compris.
Il existe des accents étrangers qui paraissent agréables et d’autres qui sont considérés comme trop durs (c’est parfois le cas des Allemands qui parlent français). Par contre une bonne prononciation peut s’accompagner d’une image positive du locuteur et lui donner un bonus de sympathie. Elle éveille l’impression que le locuteur étranger se donne du mal pour parler correctement la langue, qu’il respecte cette langue et respecte ses locuteurs, donc qu’il fait un pas vers eux. Elle peut contribuer à une intégration lorsque celle-ci est désirée, car le locuteur est considéré comme moins étranger, et elle peut développer ou rendre possible un sentiment d’appartenance.
Nous avons résumé dans le schéma ci-dessous les avantages de l’acquisition d’une bonne prononciation dans le schéma ci-dessous, tout en sachant que la liste n’est pas exhaustive.
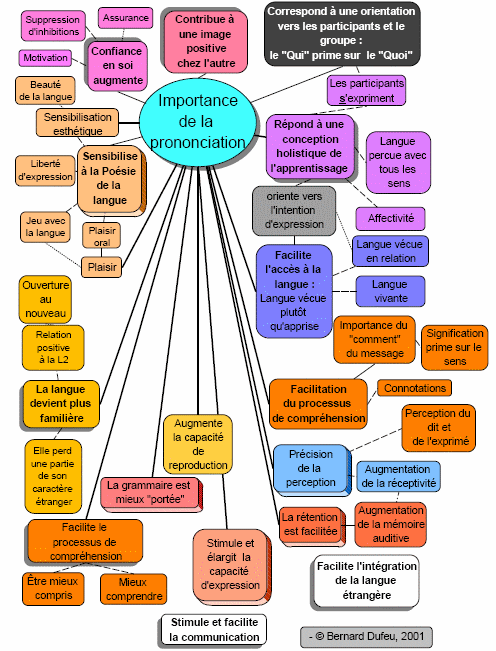
Bernard DUFEU
* Docteur en sciences de l’éducation, Bernard Dufeu a enseigné de 1966 à 2006 le français à l’université de Mayence. Il participe également depuis plus de trente ans à la formation des professeurs de langues dans différents pays, notamment lors du stage BELC d'été organisé par le CIEP. Il développe depuis 1977 la psychodramaturgie linguistique (PDL), une approche de l’apprentissage des langues qui associe, entre autres, des fondements et techniques issus du psychodrame et de la dramaturgie et qui sont adaptés à l'apprentissage des langues.
Courriel : dufeu@psychodramaturgie.de
Site : www.psychodramaturgie.de
10. Comment apprécier, par exemple, les sonorités de certains poèmes de Verlaine si on a des difficultés avec la prononciation des voyelles françaises.
11. Marcel Jousse (voir Bibliographie) parle de "manducation de la parole".
12. L’intonation influence de manière décisive la signification et la portée du message. Elle peut même complètement transformer le sens dénotatif d’un énoncé en son contraire : "Tu es fou" peut exprimer une critique ou un compliment (par exemple lorsqu’un ami offre un cadeau qui dépasse vos attentes), "T’inquiète" avec l’intonation adéquate dans la langue familière peut signifier "Ne t’inquiète pas" ou "Ne te fais pas de soucis".
13. Il est parfois plus important de comprendre ce que quelqu’un exprime que ce qu’il communique linguistiquement. Une expression comme "Cela suffit maintenant !" peut suivant la perception de son intonation prendre différents sens. "Qu'est-ce qu'elle lui met !" (quel vêtement bizarre elle met à son enfant) et "Qu'est-ce qu'elle lui met !" (Elle le bat à plat de couture) ne prennent pas seulement leur sens par leur contexte mais aussi par la différence d’intonation qui les accompagne.
14. Une expérience personnelle peut illustrer cet aspect : comme je dispose d’une prononciation anglaise particulièrement déficiente, j’ai suivi pendant une semaine un cours de prononciation en Angleterre. Je ne crois pas que ma prononciation ait été réellement améliorée à la suite de ce cours, mais les exercices proposés m’ont permis d’affiner ma perception auditive de l’anglais, si bien que je comprends mieux les anglais depuis cette époque et que j’ai eu d’ailleurs à mon retour en écoutant la BBC l’impression subjective que les Anglais parlaient plus lentement depuis ce cours. Pour des raisons pédagogiques – et peut-être personnelles – ce cours n’a pas atteint son objectif principal mais il a eu un effet secondaire fortement bénéfique.
15. Nous faisons la différence entre la mémorisation qui est un acte volontaire pour retenir quelque chose, par exemple en l’apprenant par cœur et la rétention qui consiste à retenir de manière volontaire ou involontaire certaines données.
16. La prépondérance de l’écrit dans l’enseignement conventionnel peut inhiber le développement de la mémoire auditive. La fonction mémorielle est confiée alors au papier. Si les peuples de tradition orale possèdent une meilleure mémoire, cela vient du fait qu’il est continuellement fait appel à elle et du fait que l’oral conserve une grande valeur dans leur culture. Erich Fromm observe aussi ce phénomène : "J’ai constaté à Mexico que les analphabètes et les gens qui écrivent peu ont une bien meilleure mémoire que les citoyens capables d’écrire et de lire de nos États industriels." Erich Fromm (1981 8) : Haben oder Sein, Stuttgart, DTV, S. 42.
17. Devant l’importance que nous accordons à la place de la prononciation au début de l’apprentissage, quelques lecteurs peuvent faire ici allusion aux "types d’apprenants" et objecter comme le fit dans un séminaire une américaine qui vivait depuis vingt ans en France et qui était souvent difficile à comprendre : "Je suis visual" (pour "visuel"), le mot "visual" prononcé avec son accent américain ne fut pas compris par le groupe lors de sa première émission. Elle illustrait avec cette remarque la nécessité de développer ses capacités de discrimination auditive et de reproduction pour pouvoir être comprise, être visuel ne suffisait pas.
18. La courbe mélodique de finalité sert par exemple de signal dans la communication pour indiquer à l’interlocuteur que nous avons terminé notre énoncé et qu’il peut réagir. Elle structure le déroulement de la communication.
19. "Autrefois la musique et la grammaire n'étaient point séparées. Cela est si vrai qu'Architas et Aristophène parlent de la grammaire comme d'un art qui est compris dans la musique ; et c'étaient les mêmes maîtres qui enseignaient l'une et l'autre." Quintilien : De l'instruction de l'orateur.
20. Sur les fonctions des poèmes dans l’apprentissage d’une langue voir Dufeu, 2003, p. 305-310.
21. Trocmé-Fabre, H. (1987) : J’apprends donc je suis, Paris, Éditions Organisation, 141.
22. Les poèmes, les pièces de théâtre et les discours associent l’écrit et l’oral. Ils ont été en général transcrits, mais ils sont le plus souvent destinés à être dits.
CALBRIS G. et MONTREDON J., 1975, Approche rythmique intonative et expressive du français langue étrangère, Paris, Clé.
CALBRIS G. et MONTREDON J., 1980, Oh là là !, Paris, Clé International.
CALBRIS G. et MONTREDON J., 1986, Des gestes et des mots pour le dire, Paris, Clé international.
CALLAMAND M., 1972, L'intonation expressive, exercices systématiques de perfectionnement, Paris, Hachette.
CALLAMAND M., 1981, Méthodologie de l'enseignement de la prononciation, Paris, Clé international.
CUREAU J. et VULETIC B., 1976, Enseignement de la prononciation. Le système verbo-tonal (SGAV), Paris, Didier.
DELATTRE P., 1965, Comparing the phonetic features of English, German, Spanish and French, Heidelberg, Gross Verlag.
DELATTRE P., 1966, Studies in French and comparative Phonetics, London, Paris, Mouton.
DELATTRE P., 1966, "Les dix intonations de base du français", French Review XL/1, 1-14.
DELATTRE P., 1967, "La nuance de sens par l'opposition", French Review XLI/3 Décembre 1967, 326-339.
DELATTRE P., 1969, "L'intonation par les oppositions", Le français dans le monde 64, 6-13.
DUFEU B., 1976, "Ausspracheschulung im Französischunterricht", Praxis des Neusprachlichen Unterrichts 2, 144-155.
DUFEU B., 1977, "Die phonologisierte Ausspracheschulung", In KELZ H. (Hrsg.), Phonetische Grundlagen der Ausspracheschulung, Hamburg, Buske Verlag, 147-162.
DUFEU B., 1980, "La fonction de l'intonation dans la communication en psychodramaturgie linguistique", In KÜHLWEIN W. et RAASCH A. (Hrsg.), Sprache und Verstehen, Kongressbericht der 10, Jahrestagung der GAL, Mainz, 1979, Bd. II, Tübingen, Gunter Narr, 117-119.
DUFEU B., 1981, "Intonation et mouvement corporel", In KÜHLWEIN W. et RAASCH A. (Hrsg.), Sprache: Lehren Lernen, Kongressbericht der 11. Jahrestagung der GAL, Band II, Tübingen, Gunter Narr, 108-110.
DUFEU B., 1986, "Rythme et expression", Le français dans le monde 205, 62-70 et Correctif, 1987, Le français dans le monde 208, 12-13.
DUFEU B., 1990, "Rhythmus, Melodie und Bewegung", In EGGERS D. (Hrsg.), Intonation im Fremdsprachenunterricht für Erwachsene, Mainz, Universität Mainz, Berichte und Beiträge zur wissenschaftlichen Weiterbildung Bd. 26, 53-68.
DUFEU B., 1996, Les approches non conventionnelles, Paris, Hachette.
DUFEU B., 2002, "Mouvement et poésie en Psychodramaturgie", New Standpoints, janvier, 3-5 und 50.
DUFEU B., 2003, "Wege zu einer Pädagogik des Seins", 267-316 (voir : www.psychodramaturgie.de)
GUIMBRETIÈRE É., 1994, Phonétique et enseignement de l'oral, Paris, Didier/Hatier, 1994.
GUIMBRETIÈRE É. (Hrsg.), 2000, Apprendre, Enseigner, Acquérir : La prosodie au cœur du débat, Rouen, Université de Rouen.
GUBERINA P., 1970, "Phonetic rythms in the verbo-tonal system", Revue de phonétique appliquée 16, 3-13.
JOUSSE M., 1974, Le style oral rythmique et mnémotechnique, Paris, Fondation Marcel Jousse.
JOUSSE M., 1974, L'anthropologie du geste, Paris, Gallimard.
JOUSSE M., 1975, La manducation de la parole, Paris, Gallimard.
KANEMAN-POUGATCH M. et PEDOYA-GUIMBRETIERE E., 1989, Plaisir des sons, Paris, Hatier.
LACHERET-DUJOUR A. et BEAUGENDRE F., 1999, La prosodie du français, Paris, CNRS éditions.
LANDERCY A. et RENARD R., 1977, Éléments de phonétique, Paris, Mons, Didier-CIPA.
LANGAGES, "Nouvelles phonologies", 125, Mars 1997.
LANGUE FRANÇAISE, 2000, "Où en est la phonologie du français ?", 126, Mai 2000.
LÉON M., 1969, Exercices systématiques de prononciation française, Fascicule II : rythme et intonation, Paris, Hachette/Larousse.
LÉON P., 1978, Prononciation du français standard, Paris, Didier.
LÉON P., 1971, Essais de phonostylistique, Paris, Didier.
LÉON P., 1992, Phonétisme et prononciation du français, Paris, Édition Nathan.
LÉON M. et LÉON P., 1997, La prononciation du français, Paris, Éditions Nathan.
LÉON P. et MARTIN P., 1969, Prolégomènes à l'étude des structures intonatives, Paris, Didier.
LÉON, FAURE et RIGAULT, 1970, Prosodic feature analysis, Paris, Didier.
LHOTE E., 1990, Le paysage sonore d'une langue, le français, Hamburg, Buske Verlag.
LHOTE E., 1995, Enseigner l'oral en interaction, Paris, Hachette.
LLORCA, R., 1993, "Entraîner la mémoire par les sens", Le français dans le monde 254, 50-53.
LLORCA R., 1994, "Techniques de travail oral pour l'intégration sensorielle d'une langue étrangère", Die Neueren Sprachen 93/6, 588-606.
LLORCA R., 1998, "Rythme et création : une recherche musicale sur le français parlé", Le français dans le monde 296, 35-37.
MALMBERG B., 1969, Phonétique française, Kristianstadt, Kristianstads Boktryckeri Aktiebolag.
MALMBERG B., 1984, La phonétique, coll. "Que sais-je ?", Paris, PUF.
MEISENBURG T. et SELIG M., 2004, Nouveaux départs en phonologie. Les conceptions sub- et suprasegmentales, Tübingen, Günter Narr Verlag.
PAGNIEZ-DELBART T., 1991, A l'écoute des sons, Paris, Clé international.
PIMSLEUR P., 1978, Le Pont Sonore, Paris, Hachette.
RENARD R., 1971, Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique, Paris, Didier.
RENARD R., 2002, Apprentissage d’une langue étrangère seconde. La phonétique verbo-tonale, Bruxelles, De Boeck Université.
REVUE DE PHONÉTIQUE APPLIQUÉE (RPA) Revue des représentants de la méthode verbo-tonale, 1965.
WIOLAND F., 1991, Prononcer les mots du français, Paris, Hachette.
WUNDERLI P., BENTHIM C. et KARASCH A., 1978, Französische Intonationsforschung, Tübingen, Günter Narr Verlag.
ZWANENBURG W., 1965, Recherches sur la prosodie de la phrase française, Leiden.
© Franc-parler.org : un site de
l'Organisation internationale
de la Francophonie