

Accueil > Dossiers > Du côté des associations
Les associations d’enseignants
Les associations d’étudiants
Et les élèves ?
"Adhérer à une association, pour moi,
c’est donner davantage de sens à une pratique enseignante
trop souvent tournée exclusivement vers l’intérieur
(la classe, l’équipe pédagogique, l’institution).
C’est inscrire sa pratique dans un contexte social, l’enrichir
et peut-être enrichir celle des autres, car nous ne sommes pas uniquement
des profs mais aussi des citoyens. C’est accompagner les autres
et se faire accompagner." (Haydée Silva)
"L'interaction entre le travail développé en classe
et le "monde extérieur" est une composante essentielle
des activités d’enseignement. Tout professeur de français
inscrit dans une association bénéficie de cette possibilité
de contact permanent avec ses collègues brésiliens et étrangers
à travers ce réseau solide que nous construisons ensemble
tous les jours." (Marcio Venicio Barbosa)
L'une des missions de l'association est de "coopérer avec
les associations d’enseignants de langues de la Finlande, du Danemark,
de la Norvège et des pays baltes." (Isabella Thinsz)*
La plupart des associations dont nous allons rendre compte ici sont constituées à l’échelle nationale d'enseignants qui exercent dans le même domaine ou la même discipline. Elles sont représentées dans de très nombreux pays.
Vous trouverez sur le site de la Fédération internationale des professeurs de français les coordonnées de l’ensemble des associations d’enseignants de français langue maternelle, langue seconde ou langue étrangère affiliées à la FIPF. Le site Internet du Centre international d’études pédagogiques et le site associatif du français langue étrangère (FLE-asso) proposent également un annuaire des associations de français langue étrangère. D’autres associations réunissent de façon plus large des enseignants de langues vivantes (telle l’Association des professeurs de langues vivantes en France, qui fait partie de la Fédération internationale des professeurs de langues vivantes, voir ci-dessous) ou encore des professeurs de l’enseignement bilingue (telle l’Association pour le développement de l’enseignement bilingue).
Les adhérents de ces associations ont la possibilité d'échanger ou de se rencontrer en diverses occasions au cours de l’année.
L’Association belge des professeurs de français par exemple a mis en place un projet d’échange original entre enseignants belges et étrangers : "Cet été, puis cet automne, des relations se sont nouées ou resserrées entre l’ABPF et des associations qui, dans d’autres pays, visent les mêmes buts : promouvoir la qualité de l’enseignement du français et de sa littérature. […] Nous poursuivrons les actions menées depuis plusieurs années. Nous enverrons des collègues à l’étranger : au Maroc, en Bulgarie, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en République Tchèque. Là, sur place, […] ils donneront des communications ou animeront des ateliers en didactique du FLE. De notre côté, nous accueillerons des enseignants étrangers. Ils participeront à des journées d’étude et découvriront la manière dont nous vivons la francophonie. Mais nous vous proposons une expérience originale et beaucoup plus riche ! Il s’agit d’un travail en duo. Un professeur belge francophone irait donner des cours en commun avec un collègue d’un autre pays dans l’établissement où celui-ci enseigne. Ce collègue viendrait ici faire la même expérience." (Français 2000, n° 199-200, décembre 2005).
On le voit, certaines associations ne manquent pas d'imagination. Ces rencontres peuvent avoir un caractère formel - réunions, colloques, congrès - ou informel - une Fête de Noël au Brésil, par exemple. L'essentiel est que des enseignants, qui peuvent exercer dans des régions ou des pays différents, nouent des relations entre eux.
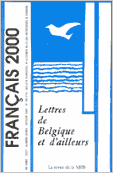
Les associations mettent également de plus en plus souvent à profit les technologies de l’information et de la communication pour favoriser les échanges entre leurs adhérents. "Cette voie est celle de la modernité, elle n’est pas celle de l’aventure", comme l'a rappelé récemment Abdou Diouf **. Elle est "une chance que les pays du Sud doivent saisir." Il n'est pas toujours facile ou même possible de se déplacer. Certaines associations l'ont bien compris, qui, pour pouvoir s'adresser à tous les publics, n'hésitent pas à utiliser ces technologies.
L’Association des professeurs de français de São Paulo, par exemple, prévoit de créer prochainement sur son site Internet un forum et un chat pour permettre à ses associés de prendre la parole et d’échanger des propos sur l’enseignement-apprentissage du FLE à São Paulo (pour en savoir plus). Trois thématiques sont proposées sur le forum : 1. Dans quels contextes le français est-il enseigné à São Paulo ? Où enseignez-vous ? À quel public ? Quels sont vos pratiques et vos besoins dans vos contextes de travail ? 2. La langue française : problèmes, difficultés, vocabulaire. 3. Que pensez-vous des révoltes qui ont lieu en ce moment en France ? L’Association des enseignants de français en Slovaquie a créé, pour sa part, un groupe de discussion destiné à faciliter la communication entre professeurs de français en Slovaquie et entre ceux-ci et le bureau de l'Association slovaque des professeurs de français et le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France.
Les fédérations
Certaines associations d’enseignants se sont regroupées
au sein de fédérations. Citons la Fédération
internationale des professeurs de langues vivantes (FIPLV) et la Fédération
internationale des professeurs de français (FIPF), dont le
congrès mondial, qui se tient tous les 4 ans, est une occasion
unique de rencontre entre enseignants de différents pays. La FIPF
organise également des rencontres à Paris et des manifestations
régionales. Elle est également à l'initiative du
programme Fadom (voir
ci-dessous).
Pour tous ceux qui se forment à l'enseignement du français langue étrangère, elles sont souvent un passage obligé. Il en existe de très nombreuses au niveau local.
L’association Terre de FLE, par exemple, centralise toutes les informations utiles aux étudiants en Master 1 ou 2 et aux jeunes diplômés en FLE de l’université de Grenoble (France) et offre aux étudiants une plateforme pour qu’ils puissent partager leurs expériences. De même, l’Association régionale de français langue étrangère regroupe tous ceux qui, dans la région Alsace, travaillent dans le domaine du FLE (formateurs, employeurs ou associations) ainsi que les anciens étudiants de la filière FLE de l'université Marc-Bloch. Son but est de favoriser les contacts entre les professionnels du domaine, qu'ils soient étudiants, professeurs ou formateurs. À ce titre, elle participe à l'organisation de journées de rencontres sur des sujets scientifiques ou professionnels, à l'organisation de "forums FLE" destinés à échanger des idées concernant les pratiques de classe et à la diffusion annuelle d'un annuaire des anciens du FLE. L’association aide également financièrement les étudiants de maîtrise FLE, membres de l'association, qui partent en stage professionnel à l'étranger.
Pour découvrir d’autres adresses, rendez-vous sur le site FLE-asso.
Le français
à domicile
Ce programme de la FIPF
propose de faire se rencontrer professeurs et étudiants. Le principe :
un professeur de français reçoit à son domicile un
étudiant venu de France. Cet étudiant s'engage à
répondre aux besoins en français du professeur : conversation,
rencontres avec les élèves, questions de vocabulaire ou
de grammaire, actualité de la musique, du cinéma, de la
presse… En échange, le professeur offre à l’étudiant
l’hébergement et les repas, il lui fait découvrir
la région et organise pour lui des rencontres avec des amis.
Pourquoi ne pas créer vous-même (ou aider vos apprenants à monter) une association pour regrouper les élèves ?
Ces associations peuvent avoir pour objet le développement de la sociabilité, des activités de détente, de jeu (foyers socio-éducatifs, associations culturelles), un soutien à caractère social ou encore être une prolongation de l’enseignement (Club théâtre, association du journal de l’établissement).
La création d’une association peut dans ce contexte présenter plusieurs avantages : offrir un cadre juridique à une action, la possibilité de mobiliser des moyens et des partenaires afin de réaliser un projet pédagogique dépassant par son ampleur ce que le fonctionnement "normal" autorise, la possibilité de recevoir des subventions. Ce peut être pour les élèves l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie associative. La création d'une association est une façon de les responsabiliser.
Si les élèves sont mineurs, ils ne bénéficieront peut-être pas du droit à créer une association. En France par exemple, les mineurs n’ont pas la capacité juridique de créer une association, cependant, depuis 1998, une structure associative est possible pour les moins de 18 ans : la junior-association. Bien qu’elle ne soit pas déclarée en préfecture, la junior-association est habilitée par le réseau national des junior-associations.
Les drôles d'oiseaux (Chambéry, France) : "Échange interculturel avec un atelier théâtre de Bignona au Sénégal. Chaque atelier travaillera sur la théâtralisation des contes de leur continent respectif. Répétitions chaque semaine de septembre à février, puis séjour d'une semaine au Sénégal pour la présentation des spectacles et des échanges sur ce qui fait notre passion : le théâtre."
Plaine d'Europe (Gonesse, France) : "Nous souhaitons aider les jeunes de notre quartier à découvrir l'Europe et créer un journal pour notre quartier. Rencontrer des jeunes d'autres pays européens et discuter avec eux. Réalisation de notre projet éducatif non formel dans le domaine des droits de l'homme et de la citoyenneté européenne."
Stylauteurs (François, Martinique) : "Projets : Rencontrer des auteurs et d'autres jeunes écrivains ; échanges littéraires et culturels entre les membres, valoriser la jeunesse ; s'améliorer grâce à des intervenants ; unifier et rassembler les jeunes écrivains antillais. Projets à long terme : publier un recueil de nos œuvres, écrire des scénarios pour le théâtre et le cinéma."
À consulter également : le site Jeunes vie associative : Initié à partir d’une réflexion commune des associations et du ministère français des Affaires étrangères au sein du groupe jeunesse de la commission coopération et développement (CCD), le programme mobilisateur Jeunes vie associative (JVA) s’inscrit dans les nouvelles orientations de développement dans de nombreux pays (décentralisation, développement local, rôle accru des collectivités locales et de la société civile, promotion des initiatives à la base...) et dans les nouvelles priorités de coopération publique et associative de la France et de nombreux autres partenaires extérieurs. L’objectif de ce programme est de faire en sorte que les jeunes, réunis en associations formelles ou informelles, puissent se connaître et se faire connaître, s’exprimer, réaliser des projets, échanger avec d’autres jeunes dans leur pays mais aussi avec des jeunes d’autres pays et avec d’autres acteurs du développement. Vous trouverez sur le site un répertoire des actions en cours, un annuaire des associations et des fiches pays qui proposent notamment des bilans de la vie associative dans plusieurs pays du monde.
* Haydée Silva est membre de l’Association des professeurs de français au Mexique. Marcio Venicio Barbosa est président de l’Association des professeurs de français de l’État de Rio de Janeiro (Bulletin d’information n° 11, novembre 2005). Isabella Thinsz est présidente de l’Association des enseignants de français en Suède.
** Troisième session du Haut Conseil de la Francophonie, Paris, le 16 janvier 2006.
Sigles des associations citées dans le dossier
© Franc-parler.org : un site de
l'Organisation internationale
de la Francophonie