

 Interview
InterviewJacqueline Picoche, agrégée de grammaire, docteur ès-lettres et professeur honoraire à l'université d'Amiens, est lexicologue et lexicographe. Paru en 2001, le Dictionnaire du français usuel, qu'elle a rédigé en collaboration avec Jean-Claude Rolland, offre un panorama du lexique français standard qui permet à l'usager de se familiariser avec un outillage lexical, ni surabondant ni trop pauvre, mis à sa disposition par la langue française. Conçu comme un dictionnaire d'apprentissage, il est découpé en 442 grands articles ayant pour entrée quelque 15 000 mots de haute fréquence, illustrés par des exemples simples qui mettent en valeur la syntaxe de ces mots.
D'où vous est venue l'idée de ce dictionnaire ? Pourriez-vous nous en présenter rapidement le concept ?
Ce “dictionnaire” est l’aboutissement de l’essentiel de mes travaux universitaires, des recherches en lexicologie que j’ai menées sur une trentaine d’années. Je voulais qu’elles ne restent pas sur le plan théorique mais qu’elles aient des applications pédagogiques. Je suis convaincue qu’il est possible de concevoir un enseignement du lexique qui ne soit pas laissé au hasard des conversations et des lectures, qui soit systématique, aussi systématique que peut l’être l’enseignement de la grammaire ou des sciences naturelles, étudiées chapitre par chapitre, selon un programme cohérent.
Des essais d’enseignement systématique existent : exercices fondés sur la morphologie (dérivation et composition) mais, la morphologie du lexique est irrégulière et cette voie ne conduit pas très loin sur le plan sémantique, ou bien exercices de constitution de champs lexicaux à partir de données extra-linguistiques qui font éclater les polysémies et ne rendent pas compte du fonctionnement réel du langage.
Jean-Claude Rolland et moi pensons qu’il est possible de constituer des champs lexicaux sur la base véritablement linguistique et sémantique que constitue la polysémie des mots lexicaux de haute fréquence, et que ces champs peuvent être à la base de cet enseignement systématique, en désaccord total avec les instructions officielles qui privilégient l’imprégnation dans l’enseignement des langues.
Le nom de “dictionnaire” que nous avons adopté faute d’un meilleur titre n’est pas tout à fait adéquat. En réalité, il s’agit de 442 grands chapitres ou leçons de vocabulaire permettant de faire le tour d’environ 15 000 mots usuels.
![]() La
tête est la principale extrémité du CORPS
des êtres vivants.
La
tête est la principale extrémité du CORPS
des êtres vivants.
Osseuse et charnue, elle comporte les principaux centres nerveux regroupés
dans l'ENCÉPHALE, les principaux organes des sens: la vue, avec
les YEUX, l'ouie, avec les OREILLES, l'odorat avec le NEZ, le gout avec
la LANGUE et la BOUCHE. Le NEZ et la BOUCHE sont aussi des parties essentielles
des systèmes RESPIRATOIRE et DIGESTIF. Sa face antérieure
est le VISAGE, dominé par le FRONT et terminé en bas par
le MENTON. De chaque côté les JOUES au-dessus desquelles
se trouvent les TEMPES. Ses faces supérieure et postérieure
sont couvertes de CHEVEUX. A1 se lave la tête : il lave
ses cheveux.
Sur quels critères vous êtes-vous appuyés pour choisir les 15 000 termes usuels recensés dans ce dictionnaire ?
Sur les travaux statistiques menés par Étienne Brunet à partir du dictionnaire des fréquences du Trésor de la Langue Française qui ont montré que les 907 premiers mots de la liste de fréquences décroissantes de ce dictionnaire couvrent 90 % du très riche corpus de textes à partir duquel il a été établi. Ces 907 mots sont le point de départ de notre travail. Nous en avons éliminé les mots grammaticaux (pronoms, prépositions, etc.) – à quelques exceptions près – et il en est resté 613, puis, en procédant par regroupements, nous sommes arrivés empiriquement à 442 mots ou groupes de mots (parfois deux ou trois) hyperfréquents devenus les titres de nos articles.
À partir de là nous avons constitué de grosses grappes de mots de moindre fréquence, 25 en moyenne par article, en utilisant toutes les ressources de la synonymie, de l’antonymie, des relations de genre à espèce, de la dérivation, et des bases savantes comme outils de dérivation. Nous avons travaillé principalement à partir des verbes en utilisant la notion d’actants, en jouant des structures actancielles et en faisant l’inventaire des noms d’actants. Enfin, nous nous sommes fiés à notre intuition pour ajouter des noms de réalités concrètes qui ne pouvaient pas être atteints par les moyens ci-dessus.
Qu'est-ce que les lexicologues peuvent apporter aux professeurs de français ? La lexicologie est-elle utile pour la formation de ces enseignants ?
Les lexicologues peuvent apporter beaucoup à tout le monde, et pas seulement aux enseignants. Une langue est constituée essentiellement d’une syntaxe qui est le mouvement même de la pensée et d’un lexique qui est le contenu de cette pensée, le résultat de toute une conceptualisation de l’univers qui s’est formée et transmise à travers les siècles, de façon différente selon les diverses sociétés constituant des communautés linguistiques. Il est extrêmement formateur pour la personnalité de ne pas se limiter à une pratique intuitive de la langue mais de prendre une conscience claire de l’organisation des concepts véhiculés par le lexique. Je suis convaincue qu’un enseignement orienté dans ce sens pourrait faire beaucoup pour l’intercompréhension des groupes ethniques et limiter la violence. Bien entendu, les enseignants sont les premiers concernés. Bien sûr, il faut distinguer la lexicologie (étude scientifique du lexique dans tous ses aspects) de la lexicographie (élaboration de dictionnaires). Personnellement, je suis une lexicologue qui s’est faite lexicographe. Mais alors que la plupart des dictionnaires existants sont des outils de consultation ponctuelle qui ne peuvent servir que tout à fait indirectement à un enseignement systématique du lexique, notre propre ouvrage est un dictionnaire d’apprentissage, conçu de façon tout-à-fait originale.
![]() Chez les hommes la tête se trouve normalement en HAUT alors
que les PIEDS sont en BAS. Sylvie a habillé Jeannot des pieds
à la tête. - Le couturier examine son mannequin
de la tête aux pieds : complètement.
Chez les hommes la tête se trouve normalement en HAUT alors
que les PIEDS sont en BAS. Sylvie a habillé Jeannot des pieds
à la tête. - Le couturier examine son mannequin
de la tête aux pieds : complètement.
Quelles sont les principales variations lexicales (géographiques, dialectales, de registre, etc.) en français ?
Les variations géographiques de notre langue (français régionaux, dialectes) sont faibles en France métropolitaine, plus importantes dans d’autres secteurs de la francophonie, mais nous ne nous en occupons pas, nous limitant à un vocabulaire usuel mais relativement restreint pouvant servir de moyen de communication à tout francophone à travers le monde.
Par contre nous attachons de l’importance aux variations de registre, autrement dit aux “niveaux de langage”, familier ou argotique (très peu mais tout de même un peu d’argot dans nos articles), savant, littéraire…
Quelle place les enseignants devraient-il à votre avis accorder en classe à la présentation de ces variations du vocabulaire français ?
Une petite place, principalement à l’occasion d’énoncés oraux ou écrits produits par les élèves.
Si l’enseignant tombe sur un mot régional, faire comprendre à l’élève qu’en l’employant, il risque de ne pas être compris en dehors de sa région. Cela pose naturellement le problème de la primauté du “français parisien cultivé”. Il n’y a pas à condamner des mots régionaux mais simplement à faire prendre conscience que ce sont des outils de communication limités alors que la francophonie est internationale et que le français doit pouvoir faire communiquer entre eux des citoyens de Montréal et de Dakar, de Paris et de Nouméa…
D’autre part si un élève emploie un mot grossier dans une circonstance imposant un niveau standard ou officiel ou, plus rarement un mot savant ou prétentieux dans un contexte familier, ou si un étranger ayant appris le “bon français” ne comprend pas un mot grossier, il faut, bien sûr le faire remarquer, c’est une question d’éducation. Mais ce n’est par le principal. C’est à la marge de l’enseignement d’un français standard de grande communication.
![]() Le mot tête et le mot chef, dans plusieurs loc.,
désignent le PREMIER élément d'un ensemble : la
tête de classe : le petit groupe des meilleurs élèves.
- la tête de liste : le premier nom d'une liste, notamment
de candidats à une élection. - la tête d'affiche
: le premier nom d'une liste de comédiens, sur une affiche
annonçant un film, une pièce de théâtre.
Le mot tête et le mot chef, dans plusieurs loc.,
désignent le PREMIER élément d'un ensemble : la
tête de classe : le petit groupe des meilleurs élèves.
- la tête de liste : le premier nom d'une liste, notamment
de candidats à une élection. - la tête d'affiche
: le premier nom d'une liste de comédiens, sur une affiche
annonçant un film, une pièce de théâtre.
Comment pensez-vous qu’un professeur de français langue seconde puisse exploiter ce dictionnaire ?
Personnellement, à la différence de mon collaborateur Jean-Claude Rolland dont la carrière s’est déroulée au CIEP et dans les Instituts français à l’étranger, j’ai toujours enseigné le français langue maternelle. Les exercices que les professeurs de français langue seconde trouveront sur mon site internet* exigeront donc de leur part certaines adaptations. Mais enfin, les principes fondamentaux de l’enseignement du lexique sont les mêmes, quel que soit le public auquel on s’adresse. J’espère donc qu’ils pourront en tirer parti.
Ces exercices sont de divers types : comment constituer une “grappe de mots” autour d’un mot difficile pour en élucider le sens, comment utiliser de façon ludique les actants des verbes. Il y trouvera aussi quelques leçons de vocabulaire greffées sur des textes littéraires dans la perspective des instructions officielles pour les collèges français. Mais surtout il y trouvera sept grandes leçons de vocabulaire (et j’en ai d’autres en réserve) intitulées respectivement APPRENDRE ET SAVOIR – ATTENTION – LIBRE ET LIBERTÉ – POINTE, PIQUER ET TROU - REVE ET RÉALITÉ- HISTOIRE, RACONTER, ÉVÈNEMENT - CONTER ET RACONTER.
Ils y verront comment la syntaxe peut être mise en relation avec le sens (différences entre apprendre à et apprendre que, entre rêver de + nom, rêver de + verbe, rêver que), la portée sémantique de l’emploi de l’indicatif ou du subjonctif, du remplacement par un nom d’une interrogative indirecte ou d’une complétive, la facilité avec laquelle les structures actancielles permettent de mettre en rapport des mots de catégories lexicales différentes (libre, droit, vouloir, pouvoir, volontiers, de bon gré), la nomination des actants (différents noms d’enseignants maître, professeur, moniteur, formateur, instructeur, etc.), la distinction de parasynonymes (savant versus cultivé), les dérivés relatifs à une seule branche d’une polysémie (apprendre à et apprentissage), les études de métaphores (pointe, creuser, se concentrer, s’appliquer) tellement spécifiques à chaque langue. On verra dans les articles HISTOIRE ou CONTER comment une leçon de vocabulaire peut servir de préambule à l’étude d’un texte ou d’un genre littéraire. Toutes ces manipulations débouchent forcément sur l’évocation de situations vécues qui peuvent tout naturellement servir de sujets à de petites rédactions où les élèves réemploieront le vocabulaire travaillé…
Je rappelle que je suis aussi l’auteur d’un manuel intitulé Didactique du vocabulaire français, épuisé chez Nathan qui est, en somme, la théorie sous-jacente à ces exercices. Il figure in extenso sur mon site et a été repris sur cédérom par les éditions Allouche.
![]() A1 humain se met sur la tête, pour la protéger ou
pour l'orner, diverses sortes de COUVRE-CHEFS (vieux et souvent ironique),
syn. de COIFFURES dont il se COIFFE. Quand ce n'est pas le cas, il est
nu-tête, syn. tête nue. - Mets-toi quelque
chose sur la tête, il y a trop de soleil !
A1 humain se met sur la tête, pour la protéger ou
pour l'orner, diverses sortes de COUVRE-CHEFS (vieux et souvent ironique),
syn. de COIFFURES dont il se COIFFE. Quand ce n'est pas le cas, il est
nu-tête, syn. tête nue. - Mets-toi quelque
chose sur la tête, il y a trop de soleil !
À la lumière de votre expérience, y a-t-il une didactique particulière du vocabulaire français lorsqu'on s'adresse à des apprenants non francophones ?
Certainement, puisque on ne peut pas s’appuyer, comme avec des élèves francophones sur une pratique intuitive de la langue maternelle.
Comment pensez-vous qu'un professeur de français langue étrangère puisse exploiter ce dictionnaire ? Quelles seraient les applications pédagogiques possibles de ce concept ?
Un collègue qui enseigne le français à des élèves de langue néerlandaise insiste sur la possibilité de tirer de cet ouvrage des exercices fondés sur les “champs actanciels” dont l’efficacité pourrait, à son avis, être très grande, au niveau secondaire et même avec des débutants, parce qu’ils permettent de travailler en relation avec la syntaxe un vocabulaire assez simple.
Je le cite : "Par exemple, la consigne de constituer un champ actanciel autour du nom cheval employé comme sujet, comme complément, comme support d’un adjectif ou d’un complément déterminatif, pourrait avantageusement remplacer la consigne trop vague, habituelle dans les manuels FLE : "Formez une bonne phrase avec tel ou tel mot", sans autre précision. Surtout, quand il s’agit de champs actanciels formés à partir de verbes, les variables A1, A2, A3, désignant les différents actants, sont faciles à manipuler ; les élèves comprennent sans difficulté ce qu’on attend d’eux. Par exemple, soit la structure A1 aime A2 : quelles catégories de A1 (plante, animal, être humain) sont possibles si A2 est : l’eau, boire, le soleil, la chaleur, avoir chaud, le poisson, la viande, bien manger, etc. ? Cela peut mener à une abondante production de phrases. Prenons l’exemple du verbe louer : "A1 humain loue un objet A2 à un autre actant humain A3 pour un certain prix et pour un certain temps". Ces exercices offrent un grand éventail de possibilités de manipulations : on peut faire varier le prix, le temps, les actants animés ou non animés entraînant à leur tour des changements contribuant à l’enrichissement du vocabulaire."
En ce qui concerne les mots hyperfréquents, il approuve la présentation qu’en donne le DFU, par exemple celle du verbe marcher, classant les sens des mots du concret à l’abstrait, du propre au figuré, qui converge avec la procédure respectée par les manuels FLE en Flandre. La mise en lumière de l’unité du polysème aide à comprendre l’enchaînement de ses différents sens.
Mais d’une façon générale, les exercices qui concernent les familles de mots, la relation entre mots populaires et dérivés savants, ceux où l’on demande de préciser des différences subtiles entre les items d’une liste paradigmatique (discours, exposé, sermon, harangue) supposent connu un vocabulaire assez abondant, dont les élèves ne possèdent que quelques éléments, et ne seraient possibles que si une traduction était donnée pour les éléments ignorés. Beaucoup ne conviendraient qu’à des étudiants qui continueraient des études de français à l’université.
Il faut savoir que les élèves néerlandophones, à raison de 4 heures par semaine, pendant les six années de leur cursus secondaire, apprennent 5 à 800 mots nouveaux par an, soit en tout à peine 5 000 mots. C’est dire que, même en y ajoutant les 4 000 mots pratiquement semblables en néerlandais et en français, faciles à deviner, les 15 000 mots usuels du DFU constituent un objectif trop ambitieux pour eux. C’est dire aussi qu’une version allégée du DFU, plus adaptée aux publics de langues maternelles autres que le français, et éditée sous une forme plus maniable serait bien souhaitable.
Jacqueline Picoche
Note :
* Le site internet de Jacqueline Picoche présente des extraits significatifs du DFU, des articles pédagogiques et, in extenso, deux de ses ouvrages épuisés concernant le lexique : Structures sémantiques du lexique français et Didactique du vocabulaire français.
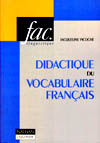

© Franc-parler.org : un site de
l'Organisation internationale
de la Francophonie